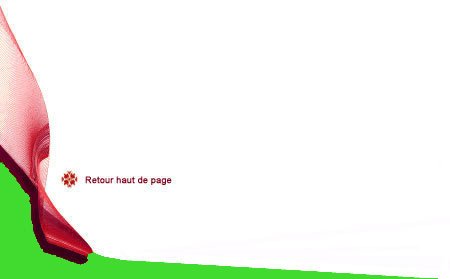|
Historique |
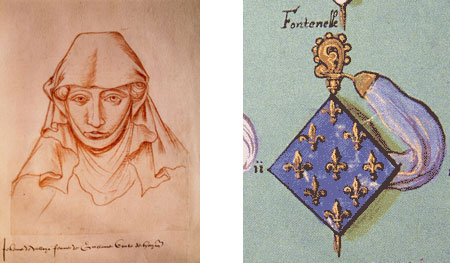
Jeanne de Valois (Bibliothèque
Municipale d'Arras) et Blason de l'abbaye de Fontenelle (albums de Duc
de Croÿ)
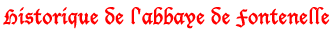


"Deux vertueuses demoiselles, Jeanne et Agnès, fille de
Hélin, chevalier seigneur d'Aulnoy
(1), fondèrent un petit
oratoire en l'honneur de la glorieuse
"Vierge"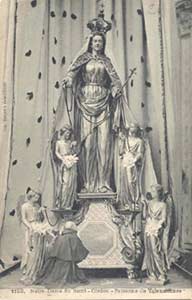
Marie, auprès de la fontaine
de Notre-Dame-aux-Pierres, entre l'Escaut et le grand chemin qui mène de Valenciennes à Cambrai,
là où était jadis
l'ermitage de Bertholin, Saint Homme à qui Notre Dame apparut quand elle voulut
chasser la peste (de Valenciennes) l'entourant d'un cordon......"
(2)
Adossé
à cet oratoire, qui fut donc appelé Fontenelle, les
deux sœurs bâtirent un corps de logis.

Transplantées un peu plus bas en 1214, Jeanne, Agnès et leurs compagnes
ne furent autorisées à construire l'église dont elles rêvaient qu'en
1216, à cause de l'hostilité de l'abbé de Crespin. C'est donc en 1216
que commence l'histoire de l'abbaye de Fontenelle avec la construction
de l'église dédiée à Notre Dame.
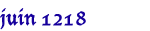
Adoption de la règle de Cîteaux, moyennant la permission d'Arnaud, abbé
de Cîteaux et de Guillaume, abbé de Clairvaux.
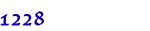
Havide de Condé, première abbesse, ratifie
cette résolution.

L'abbaye se développa rapidement dès sa
création; de nombreux dons lui furent faits par
des seigneurs parents et amis.
Mais
c’est au XIVe siècle
qu’elle atteint la renommée avec la venue en 1337 de Jeanne de
Valois (3),
veuve du comte de Hainaut Guillaume Ier Le Bon, sœur du roi de France
Philippe VI
(4), belle-mère de l’empereur Louis de Bavière, du roi Edouard
III d’Angleterre
(5) et du duc de Juliers.
Jeanne
de Valois, qui avait été précédée à Fontenelle dès 1300 par sa
belle-sœur, Jeanne de Hainaut, y entraîna sous le voile avec elle sa
petite-fille Anne de Bavière. Plus tard une autre fille, Isabelle de
Namur, devait y être inhumée à leurs côtés .
Ainsi
c’est une des familles les plus puissantes de l’Europe d’alors qui
fera la célébrité de l’abbaye.
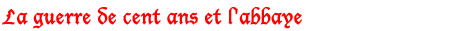
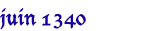
Les français, en se retirant sur Cambrai
après une expédition dévastatrice dans le Hainaut, brûlent en partie l'abbaye de Fontenelle.
Le
duc de Normandie, eu égard à sa tante qui s’y était retirée, fait
immédiatement châtier les soudards.
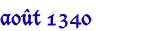
Jeanne de Valois sort de sa
retraite, à l’appel de son frère le roi
Philippe VI, pour rencontrer sa
fille Philippa
(6), reine d’Angleterre, afin
d’obtenir l’arrêt des hostilités qu’elle parviendra finalement à
imposer elle-même par la Paix de Tournai.
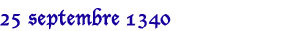
Une trêve de dix mois est conclue entre la
France et l'Angleterre, renouvelée deux fois de
suite par la comtesse Jeanne, et qui permettra au Hainaut de sortir du
conflit franco-anglais pour les cent ans à venir.


Jeanne de Valois meurt à l'abbaye. Elle est
enterrée au milieu du chœur des Dames dans l'abbatiale. Elle avait fait de Fontenelle
une abbaye riche, un centre politique momentané, un lieu de rencontre de la
noblesse. Par la suite, l’abbaye coule des jours propices, éloignée de l’agitation
mondaine, dans la ferveur des moniales.


L'armée de Charles Quint, en guerre contre le
roi Henri II, campe durant six semaines au Mont Houy, elle est commandée
par Philibert Emmanuel, Prince de Piémont.
Celui-ci loge à l'abbaye
en compagnie des principaux chefs de son armée.

A Valenciennes, une foule de réformés déferle sur les lieux
de culte catholique. L'abbaye de Fontenelle n'est pas épargnée. Cette
explosion de colère se reproduira en janvier, avant que la rébellion ne
soit matée et durement réprimée.
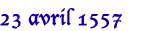
L'abbesse et ses religieuses reviennent à
Fontenelle. Elles restaurent la chapelle de Saint-Bernard.

Des voleurs surprennent de nuit l'abbaye.
L'abbesse décide d'envoyer ses religieuses en partie à l'abbaye de
Spirlieu (près de Mons), en partie à l'abbaye d'Ath, quant à elle, avec
quelques religieuses, elle se retire au Quesnoy dans l'abbaye de
Sainte-Elisabeth, puis toutes se retrouvent au refuge de Valenciennes.
(7)
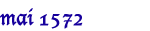
Ce refuge est pillé et dévasté par des
Valenciennois en révolte contre le Duc d'Albe, Gouverneur des Pays-Bas,
représentant le Roi d'Espagne.

Retour des religieuses en leur abbaye

La région de Valenciennes connaissant de
nouveaux troubles, les religieuses doivent retourner dans leur refuge de
Valenciennes. L'abbesse estima nécessaire d'améliorer celui-ci et de le
rendre apte à y célébrer la messe.
Toutes ces destructions et reconstructions
se passèrent sous l'abbatiat de Marie Le Poyvre


Dame Catherine Le Moisne, voyant que la paix
semble assurée en Hainaut, fait revenir ses religieuses à Fontenelle.
Mort de Dame Catherine Le Moisne.
Dame Louise de Barbaize
(8), qui lui succède, entreprend de restaurer l'abbaye.

Les hostilités commencent entre Français et
Espagnols. Valenciennes est le centre de batailles qui ravagent le pays.

Les religieuses décident de se réfugier dans
leur refuge de Valenciennes.

Des coureurs français (soldats chargés de
parcourir la région pour piller ou trouver du ravitaillement) entrent
dans l'abbaye après la prise de Condé.

Valenciennes est encerclée par les Français,
le couvent est pillé, le quartier abbatial, les clôtures, l'infirmerie,
les basses-cours, les granges démolis. Quant au reste de la propriété,
il est inondé.

Durant la nuit, l'armée espagnole, commandée
par Don Juan d'Autriche
(9) et le Prince de Condé, rompt les lignes des
assiégeants et force les Français à se retirer. Ce secours ne sauva pas
Fontenelle, les vainqueurs, cantonnés à Trith et à Maing, continuent le
pillage, emportant les portes de l'église, les stalles du chœur ainsi que
les chaînes du pont-levis.
La période qui suivit, plus calme jusqu'à la
Révolution, fut consacrée en partie à la restauration de l'abbaye.
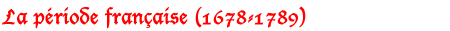
Après une période assez longue, qui aboutit en
outre à la prise de Valenciennes (1677), Louis XIV, par le traité de
Nimègue (1678), annexe notre région à son royaume.
A partir de 1678, Louis XIV nomme en personne les abbesses de
Fontenelle, dont la première en titre fut Dame Anne Dufrêne qui fit
reconstruire les fermes de Monchaux et dans
l’abbaye, la deuxième cour du cloître.
Quant au cloître lui-même, il n'était pas terminé à la
Révolution.
L'abbaye connaîtra durant cette période un moment de paix, ce qui lui
permettra de retrouver l'éclat qu'elle avait eu dans le passé.
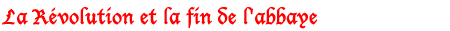
C'est sous l'abbatiat de Dame Farez, trente
sixième abbesse de Fontenelle qu'eut lieu la Révolution. Devant la
tournure des évènements, celle-ci céda le pouvoir à sa prieure,
Henriette Castillon.
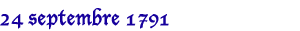
La communauté se sépare et les dames se
cachent où elles peuvent. L'abbaye est mise sous scellés et vendue comme
bien national à un négociant, le sieur Rémi Pillion, le bois et la
ferme attenante de Fontenelle sont adjugés à monsieur Perdry Cadet.

Siège de Valenciennes. Toute l'abbaye est
saccagée et brûlée.

De nouveaux acquéreurs entreprennent des
fouilles pour extraire les pierres nécessaires à la confection des
routes.
(10)

L’emprise
monastique est ensuite nivelée. Ne persisteront jusqu’à la fin du XIXe
siècle que la ferme et les fossés dont quelques-uns sont encore
actuellement visibles .

Aménagement d'un bassin de décharge pour le
dragage de l'Escaut. Ces travaux sont à l'origine de la brusque
réapparition des vestiges.
|
|
|
  |
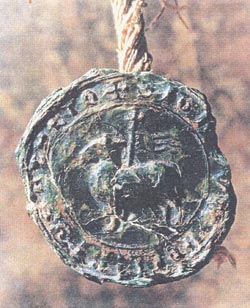
|
|
|
1.
Sceau d'Hellin
d'Aulnoy, chevalier, père de Jeanne et d'Agnès, les fondatrices de l'abbaye de
Fontenelle, représentant un Agnus Dei
(photo ADN J.Y. Populu)
|
|
  |

|
|
|
2.
Le miracle (Hubert Cailleau, 1552)
manuscrit 1183
de la Bibliothèque de Douai
|
|
  |

|
|
|
3.
Jeanne de Valois
(Bibliothèque Municipale
d'Arras)
|
|
  |

|
|
|
4.
Sceau de Philippe VI de Valois, frère de Jeanne de Valois
|
|
  |

|
|
|
5. Edouard III,
rendant hommage à Philippe VI pour la Guyenne et le Ponthieu
(Amiens, 1329 -
Bibliothèque Nationale de France)
|
|
  |

|
|
|
6.
Philippa de Hainaut, reine
d'Angleterre et fille de Jeanne de Valois(Queens
of England, 1894)
|
|
  |
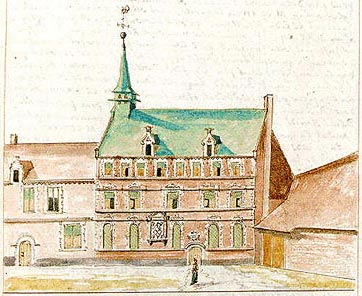
|
|
|
7. Le refuge des
dames de Fontenelle à Valenciennes (Histoire ecclésiastique de la ville et comté
de Valenciennes, de Simon Leboucq)
Bibliothèque Municipale de Valenciennes<BR>
manuscrit MS 673
|
|
  |

|
|
|
8.
Lame funéraire de Loyse de Barbaize, église de Maing
(voir visite de l'église)
|
|
  |

|
|
|
9.
Don Juan d'Autriche devant
Valenciennes
|
|
  |
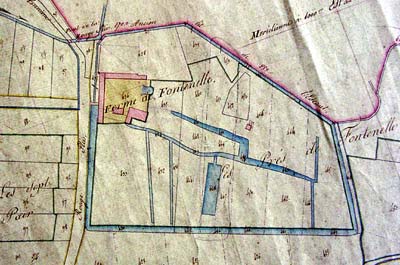
|
|
|
10. Restes de
l\'abbaye visibles sur le cadastre de 1831
Archives Départementales du Nord
|
|
  |

|
|
|
11.
Le chantier de fouilles en 1977
|
|