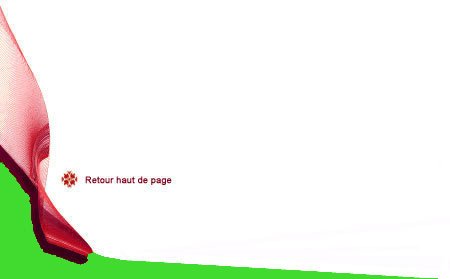|
1
2
3 4


Plusieurs mentions de Guillaume de Maing
(1), dans l'entourage du comte Bauduin VI
de Hainaut et du seigneur Renier II de Trith, son homme de confiance, qui le
suivit lors de la Croisade et fut Duc de Philippopolis, à l'origine du
croissant sur le blason de la ville de Trith. Il est encore cité au milieu du
XIIIe siècle, ainsi que Dame Rikaut de Maing.
(2)

Une première
fondation, sur le site de l’ermitage de Bertholin, d'un oratoire et d'un
béguinage par Jeanne et Agnès, filles du
seigneur d’Aulnoy, est à l’origine de
l’abbaye de
Fontenelle.
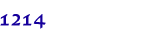
Grâce au soutien du seigneur d'Aulnoy et d'Amand de Pont, cette communauté
s’établit plus près de l’Escaut, sur un terrain plus riche
en sources, appartenant à l'abbaye de Crépin, et adopte la règle de Cîteaux.

La seigneurie de Trith (et Maing ?) est tenue par Gilles de Trith, fils (ou
neveu) de Rénier II deTrith.

Les
nouveaux habitants du fief de Ciply (Hameau de
l’Hôpiteau) sont placés sous la juridiction spirituelle de la cure paroissiale de Maing.

Par diverses alliances familiales, la seigneurie de Trith et Maing échoit
aux
seigneurs du Roeulx, Eustache puis Gilles, son frère.[ référence :
J. Trotin, les seigneurs de Trith et Maing ]

1298 : Acte d'échevinage ( ADN 32 H 22 ) dans lequel apparaît le nom de
Willaume Nazet, premier maire connu de Maing et Trith.
La fin du XIIIe siècle est une période de progrès et d'expansion
démographique pour Maing et le Hainaut. Elle se traduit par l'essor rapide
de l'abbaye de Fontenelle, par une première évolution architecturale
significative de l'église de Maing et la confirmation dans les actes
écrits de son statut de paroisse.

Le XIVe siècle est sans nul doute l'une des périodes les plus riches et
les plus fortes de l'histoire de Maing.

Acte d'échevinage ( ADN 32 H 6 ) par lequel Gilles ou Gillon, premier curé
connu de la paroisse de Maing vend au fermier de l'abbaye de Fontenelle une
terre de l'héritage familial.

Ce sont deux dates fondamentales dans l'histoire médiévale de Maing , où
la destinée de la communauté va prendre une autre dimension. En 1322,
Fastreit du Roeulx vend au comte Guillaume Ier de Hainaut
(3)
son fief de Trith et
Maing, que le comte lui rend aussitôt en usufruit; en 1325, Fastreit, par
" déshéritement ", remet son fief au comte Guillaume, reconnu
comme seul seigneur de Trith et Maing. A partir de 1327, la seigneurie
relève directement des comtes de Hainaut. [ Référence : J. Trotin, les
seigneurs de Trith et Maing ]

Le comte Guillaume accorde à Jean Bernier, son prévôt-le-comte,
l'autorisation de fortifier (plutôt que bâtir) sa " Maison de Maing
", le Château des Prés.
(4)

Fuyant l'Angleterre, accusée de complot par son époux Edouard II, la Reine
Isabelle et son fils le futur Edouard III, venant d' Haspres, escortés par
Jean de Beaumont, frère de Guillaume Ier, passent à Maing et s'arrêtent à l'abbaye de Fontenelle, avant d'entrer
dans Valenciennes pour y chercher secours auprès du comte de Hainaut et de
Jeanne de Valois (sa cousine). Le mariage entre le Prince Edouard et Philippa de Hainaut
y est alors décidé.

Charte de comte Guillaume Ier de Hainaut
(5)
(6) C'est un document
majeur dans notre histoire, témoignant de l'intérêt et de
l'administration raisonnée du comte Guillaume " le Bon ". Cette
charte accorde d'abord aux gens de Trith et Maing un droit de plantis en
certains lieux, dont la vente servirait à entretenir les chemins. Elle
octroie aussi aux gens de Maing l'établissement d'un marché hebdomadaire,
assorti de franchises pour ceux qui y viendraient. Ces deux décisions vont
bien entendu favoriser l'essor de la communauté.
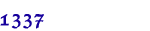
Décès du comte Guillaume, le 7 juin 1337, à
Valenciennes. Il est inhumé dans l'église des Frères Mineurs de Saint
François, auprès de son père Jean II d'Avesnes. Sa veuve
Jeanne de Valois
se retire simple religieuse à l'abbaye de Fontenelle. Le nouveau comte de
Hainaut est leur fils, Guillaume II.

Jean Bernier est accusé d'intelligence avec le Roi de
France. Il est désavoué par le comte Guillaume II. Ses biens sont
confisqués, en particulier le Castel des Prés à Maing, qui est racheté
comme bien séquestré par Jean de Neuville.

Début du conflit franco-anglais . Jeanne de Valois
reçoit son gendre le Roi d'Angleterre Edouard III
(7)
(8)
à l'abbaye de Fontenelle
et tente d'apaiser les esprits.

Au mois de juin 1340, Jean ( le futur Jean le Bon), Duc de
Normandie, fils aîné du Roi de France Philippe VI, à la tête d'une
armée, tente de convaincre la ville de Valenciennes de se rallier au Roi de
France. D'abord repoussés par les Valenciennois, les Français sont ensuite
assaillis et malmenés par Gérard de Verchain, Sénéchal de Hainaut. Une
troupe Française, conduite par le Seigneur Guillaume de Craon, attaque et
sans doute endommage " la Tour de Maing " (le Château des
Prés), puis passe l'Escaut à Prouvy et part attaquer Trith. Une nouvelle
fois le Sénéchal de Hainaut sort de Valenciennes et porte secours aux gens
de Trith. Il y rencontre et capture Jean Ier Le Meingre, futur
Maréchal Boucicaut qu'il ramène prisonnier dans Valenciennes. Le Duc Jean
se retire , après une sortie décisive des Valenciennois, auxquels, selon
D'Outreman, se seraient joints quelques seigneurs Anglais, dont un nommé
Jean Kieret, tué sur " le pont de Maing ". En se retirant,
quelques soudards saccagent et " brûlent " Maing et l'abbaye de
Fontenelle, lieu de retraite de Jeanne de Valois, tante du Duc Jean.
Celui-ci fait immédiatement châtier les coupables. En août 1340, Jeanne
de Valois quitte une fois de plus sa retraite et part en Flandres rencontrer
sa fille Philippa. Sa ténacité aboutira à la Paix de Tournai : le Hainaut
sera désormais épargné.

Le comte Guillaume II accorde son pardon aux Berniers.
Certains biens leur sont restitués, mais pas le Château des Prés.

La Grande Peste, la Peste Noire. Elle fut selon Philippe
Contamine " la plus grande catastrophe démographique de toute
l'histoire médiévale ". Selon les régions, entre 1/8 et 1/3 de la
population fut victime de ce fléau. La communauté maingeoise ne fut sans
doute pas épargnée.

Jeanne de Valois s'éteint à l'abbaye de Fontenelle le 7
mars 1352. Elle est inhumée au milieu du chœur des Dames.

la famille Bruniaus
Les Bruniaus étaient sans doute une famille de Bourgeois aisés de
Valenciennes, occupant des fonctions dans l'administration communale. Ils
possédaient des biens importants à Maing (dont une terre de 13
mencaudées qu'ils donnent à l'abbaye), preuve supplémentaire de l'attrait
exercé par notre commune sur l'entourage du comte, à la suite de Jean
Bernier. Certains de ces biens sont encore attestés au 17ème siècle. Ils
étaient absolument contemporains de Guillaume Ier et de Jeanne de Valois,
qu'ils ont connue à Valenciennes et à Fontenelle. Ils ont, comme elle,
désiré y être inhumés, comme en témoigne leur
remarquable lame
funéraire (9) Elle est classée Monument
Historique. Elle représente en buste les cinq membres de la famille :le père Jehan Bruniaus (10), sa femme
Clémence de Bousies (11), la fille Mague (12), le fils Jehan Bruniaus (13) et la belle-fille Marie de Vienne (14). Sous leurs cinq effigies,
une inscription sur 2 lignes établit une donation en faveur des pauvres. (Sacent tout con doit donner pour les armes de Brunel et de demizielle Climence se feme et de leur anciseurs tou les mois de l’an a tous jours II witeus de pain quit a VIII d pries dou mille A tous les paures de le ville ki sont au moustier le jour con fait le siervice et est ces bles bien asenes sur XIII mencaus de tierre si qu’il appert par le tiestament ki est en le glise de F....)

Premier dénombrement
(référence : M. Arnould, " les dénombrements de foyers dans le
comté de Hainaut aux XIVe, XVe et XVIe
siècles)
En 1365 a lieu le premier dénombrement connu concernant Maing.
Maing, Trith,
Verchigneul et le hameau de Pont recensent alors 202 foyers, ce qui pourrait
correspondre à environ 1000 habitants.

1375 : Comptes de la mairie de Trith et de Maing
"Comptes des
mairies aforaines de la prévostet "(ADN - B / 20190)
Dans ce
manuscrit sont enregistrées les recettes et les dépenses de la mairie de
Trith et de Maing en 1375 et 1376. Il nous livre les détails de certaines
" infractions " du XIVe siècle : " biestes qui furent
damaige faisant ", " brebis prises aux waresons ", "
vacques qui furent prises aux avoines des pauvres gens ", " pour
une mélée qu'il fit à l'encontre de Roger Maucorps ". Il nous donne
un premier aperçu de la population des deux communautés.

Le dimanche 5 février 1380, le maïeur Jacques de Ruielle convoque les plaids généraux en l’église, et assisté des échevins et des chefs de familles des communautés de Trith et de Maing, il procède à la codification des « bonnes coustumes » locales.
Ce « Record des Coutumes de Trith et de Maing » comporte 39 articles.
Ces règlementations, issues du consentement collectif, concernaient les moulins et fours banaux, les corvées, la clôture des terres, l’entretien des cours d’eau et l’utilisation des waréchaix (terrains communaux).
(références : Léo Verriest – René Guillez : exposé de l’A G de mars 1984)
Suite du
chapitre "Histoire"
|
|